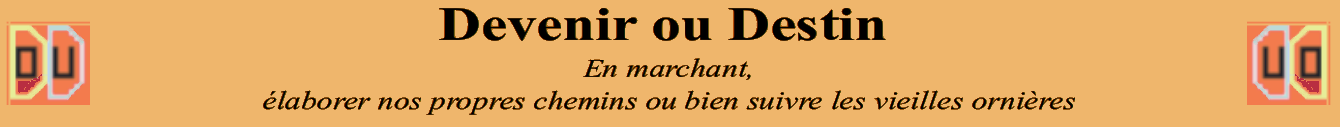L’enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain
Editions Gallimard, 1949
« Ainsi il n’y a rien, hors l’État, où la fidélité puisse s’accrocher. C’est pourquoi jusqu’à 1940 elle ne lui avait pas été refusée. Car l’homme sent qu’une vie humaine sans fidélité est quelque chose de hideux. Parmi la dégradation générale de tous les mots du vocabulaire français qui ont rapport à des notions de morales, les mots de traître et de trahison n’ont rien perdu de leur force. L’homme sent aussi qu’il est né pour le sacrifice ; et il ne restait plus dans l’imagination publique d’autre forme de sacrifice que le sacrifice militaire, c’est-à-dire offert à l’État.
Il s’agissait bien uniquement de l’État. L’illusion de la Nation, au sens où les hommes de 1789, de 1792, prenaient ce mot, qui faisait alors couler des larmes de joie, c’était là du passé complètement aboli. Le mot même de nation avait changé de sens. En notre siècle, il ne désigne plus le peuple souverain, mais l’ensemble des populations reconnaissant l’autorité d’un même État ; c’est l’architecture formée par un État et le pays dominé par lui. Quand on parle de souveraineté de la nation, aujourd’hui, cela veut dire uniquement souveraineté de l’État. Un dialogue entre un de nos contemporains et un homme de 1792 mènerait à des malentendus bien comiques. Or non seulement l’État en question n’est pas le peuple souverain, mais il est identiquement ce même État inhumain, brutal, bureaucratique, policier, légué par Richelieu à Louis XIV, par Louis XIV à la Convention, par la Convention à l’Empire, par l’Empire à la IIIe République. Qui plus est, il est instinctivement connu et haï comme tel.
Ainsi on a vu cette chose étrange, un État, objet de haine, de répulsion, de dérision, de mépris et de crainte, qui, sous le nom de patrie, a réclamé la fidélité absolue, le don total, le sacrifice suprême, et les a obtenus, de 1914 à 1918, à un point qui a dépassé toute attente. Il se posait comme un absolu ici-bas, c’est-à-dire comme un objet d’idolâtrie ; et il a été accepté et servi comme tel, honoré d’une quantité effroyable de sacrifices humains. Une idôlatrie sans amour, quoi de plus monstrueux et de plus triste ?
[...]
Poser la patrie comme un absolu que le mal ne peut souiller est une absurdité éclatante. La patrie est un autre nom de la nation ; et la nation est un ensemble de territoires et de populations assemblés par des événements historiques où le hasard a une grande part, autant que l’intelligence humaine peut en juger, et où se mélangent toujours le bien et le mal. La nation est un fait, et un fait n’est pas un absolu.
[...]
Quand il s’agit de soi-même, et même de sa famille, il est plus où moins admis qu’il ne faut pas trop se vanter soi-même, qu’il faut se défier de ses jugements lorsqu’on est à la fois juge et partie, qu’il faut se demander si les autres n’ont pas au moins partiellement raison contre soi-même, qu’il ne faut pas trop se mettre en avant, qu’il ne faut pas penser uniquement à soi-même ; bref qu’il faut mettre des bornes à l’égoïsme et à l’orgueil. Mais en matière d’égoïsme national, d’orgueil national, non seulement il y a une licence illimitée, mais le plus haut degré possible est imposé par quelque chose qui ressemble à une obligation. Les égards envers autrui, l’aveu des torts propres, la modestie, la limitation volontaire des désirs, deviennent dans ce domaine des crimes, des sacrilèges. [...]
Il y a des fautes de goût que la bonne éducation, à défaut de la morale, empêche de commettre dans la vie privée, et qui semblent absolument naturelles sur le plan national. Même les plus odieuses des dames patronnesses hésiteraient à rassembler leurs protégés pour leur exposer dans un discours la grandeur des bienfaits accordés et de la reconnaissance due en échange. Mais un gouverneur français d’Indochine n’hésite pas, au nom de la France, à tenir ce langage, même immédiatement après les actes de répression les plus atroces ou les famines les plus scandaleuses ; et il attend, il impose des réponses qui lui fassent écho.
C’est une coutume héritée des Romains. Ils ne commettaient jamais de cruautés, ils n’accordaient jamais de faveur, sans vanter dans les deux cas leur générosité et leur clémence. [...]
Notre patriotisme vient tout droit des Romains. C’est pourquoi les petits Français sont encouragés à en chercher l’inspiration dans Corneille. […Le peuple romain] était vraiment un peuple athée et idolâtre ; non pas idolâtre de statues faites en pierre ou en bronze, mais idolâtre de lui-même. C’est cette idolâtrie de soi qu’il nous a léguée sous le nom de patriotisme.
[...]
La Renaissance a été une résurrection d’abord de l’esprit? grec, puis de l’esprit? romain. C’est dans cette seconde étape seulement qu’elle a agi comme un dissolvant du christianisme. C’est au cours de cette seconde étape qu’est né la forme moderne du patriotisme. Corneille a eu raison de dédier son Horace à Richelieu, et de le faire en termes dont la bassesse est un pendant à l’orgueil presque délirant qui inspire la tragédie. Cette bassesse et cet orgueil sont inséparables ; on le voit bien aujourd’hui en Allemagne. Corneille lui-même est un excellent exemple de l’espèce d’asphyxie qui saisit la vertu chrétienne au contact de l’esprit? romain. [...]
[...]
L’obligation est un infini, l’objet ne l’est pas. Cette contradiction pèse sur la vie quotidienne de tous les hommes, sans exception, y compris ceux qui seraient tout à fait incapables de la formuler même confusément. Tous les procédés que les hommes ont cru trouver pour en sortir sont des mensonges.
L’un d’eux consiste à ne se reconnaître d’obligations qu’envers ce qui n’est pas de ce monde. Une variété de ce procédé constitue la fausse mystique, la fausse contemplation. Une autre est la pratique des bonnes œuvres accomplie dans un certain esprit?, "pour l’amour de Dieu", comme on dit, [...]
Un autre procédé consiste à admettre qu’il y a un ou plusieurs objets enfermant cet absolu, cet infini, cette perfection qui sont essentiellement liés à l’obligation comme telle. C’est le mensonge de l’idolâtrie.
Le troisième procédé consiste à nier toute obligation. On ne peut pas prouver par une démonstration de l’espèce géométrique que c’est une erreur, car l’obligation est d’un ordre de certitude bien supérieur à celui où habitent les preuves. En fait, cette négation est impossible. Elle constitue un suicide spirituel?. Et l’homme est ainsi fait qu’en lui la mort spirituelle? s’accompagne de maladies psychologiques elles-mêmes mortelles. En fait, l’instinct de conservation empêche que l’âme fasse davantage que s’approcher d’un tel état ; et même ainsi elle est saisie d’un ennui qui la transforme en désert. Presque toujours, ou plutôt presque certainement toujours, celui qui nie toute obligation ment aux autres et à lui-même ; en fait il le reconnaît. Il n’est pas d’homme qui ne porte parfois des jugements sur le bien et le mal, ne fût-ce que pour blâmer autrui.
Il faut accepter la situation qui nous est faite et qui nous soumet à des obligations absolues envers des choses relatives, limitées et imparfaites. Pour discriminer quelles sont ces choses et comment peuvent se composer leurs exigences envers nous, il faut seulement voir clairement en quoi consiste leur relation avec le bien.
Pour la patrie, les notions d’enracinement, de milieu vital, suffisent à cet effet. [...] Comme il y a des milieux de culture pour certains animaux microscopiques, des terrains indispensables pour certaines plantes, de même il y a une certaine partie de l’âme en chacun et certaines manières de penser et d’agir circulant des uns aux autres qui ne peuvent exister que dans le milieu national et disparaissent quand un pays est détruit.
[...]
Si la patrie est considérée comme un milieu vital, elle n’a besoin d’être soustraite aux influences extérieures que dans la mesure nécessaire pour le demeurer, et non pas absolument. L’État cesse d’être de droit divin le maître absolu des territoires dont il a la charge ; une autorité raisonnable et limitée sur ces territoires, émanant d’organismes internationaux et ayant pour objet des problèmes essentiels dont les données sont internationales, cesseraient d’apparaître comme un crime de lèse-majesté. Il pourrait aussi s’établir des milieux pour la circulation des pensées, plus vastes que la France et l’englobant, ou liant certains territoires français à des territoires non français. Ne serait-il pas naturel?, par exemple, que dans un certain domaine la Bretagne, le pays de Galles, la Cornouaille, l’Irlande, se sentent des parties d’un même milieu ?
Mais de nouveau, plus on est attaché à ces milieux non nationaux, plus on veut conserver la liberté nationale, car de telles relations par-dessus les frontières n’ont pas lieu pour les populations asservies. C’est ainsi que les échanges de culture entre pays méditerranéens ont été incomparablement plus intenses et plus vivants avant qu’après la conquête romaine, alors que tous ces pays, réduits au malheureux état de provinces, sont tombés dans une morne uniformité. Il n’y a échange que si chacun conserve son génie propre, et cela n’est pas possible sans liberté.
[S’il est bien évident qu’en découpant mes extraits il m’est arrivé plus d’une fois de tirer la pensée de l’auteur vers la mienne, jamais je n’avais encore eu le sentiment de trahir. Le cas de Simone Weil est plus difficile : j’efface autant que je le peux son mysticisme et son patriotisme, deux sentiments qui me sont absolument étrangers. Mais il arrive que je ne puis les retirer sans retirer en même temps le meilleur de la substance de son texte. Dans ces cas-là je m’en abstiens, bien sûr, et j’ai pourtant l’impression de trahir. Mais, elle-même ne se trahit-elle pas quelques fois (voir plus loin) ?] [1]
D’une manière générale, si l’on reconnaît l’existence d’un grand nombre de milieux porteurs de vie, la patrie ne constituant que l’un d’entre-eux, néanmoins, quand elle est en danger de disparaître, toutes les obligations impliquées par la fidélité à tous ces milieux s’unissent dans l’obligation unique de secourir la patrie. Car les membres d’une population asservie à un État étranger sont privés de tous ces milieux à la fois, et non pas seulement du milieu national. [...]
[ ??? Curieux ! car n’est-ce pas elle-même qui écrit, plus haut dans le même texte, "L’État est une chose froide qui ne peut pas être aimée ; mais il tue et abolit tout ce qui pourrait l’être" ? Pourquoi, alors, l’État étranger – pour le moment étranger – serait-il pire que l’État sous la domination duquel l’on se trouve à présent ? Il est d’ailleurs assez ahurissant de constater que Simone Weil est capable de longuement parler de la seconde guerre mondiale en la présentant uniquement comme un conflit entre États, elle qui pourtant, quelques années plus tôt, s’est rendu en Espagne pour combattre le franquisme aux côtés des républicains, des anarchistes ! Et moi qui croyait que cette guerre mondiale avait été une lutte contre le nazisme et l’antisémitisme !]
[...]
La France a un Empire, et par suite, quelle que soit la position de principe adoptée, il en découle des problèmes de fait qui sont très complexes et très différents selon les localités. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il se pose d’abord une question de principe ; et même quelque chose de moins précis encore, une question de sentiment. Dans l’ensemble, un Français a-t-il lieu d’être heureux que la France ait un Empire, et d’y penser, d’en parler avec joie, avec fierté, et sur le ton d’un propriétaire légitime ?
Oui, si ce Français est patriote à la manière de Richelieu, de Louis XIV ou de Maurras. Non, si l’inspiration chrétienne, si la pensée de 1789 sont indissolublement mélangées à la substance même de son patriotisme. Toute autre nation avait à la rigueur le droit de se tailler un Empire, mais non pas la France ; pour la même raison qui a fait de la souveraineté temporelle du pape un scandale aux yeux de la chrétienté. Quand on assume, comme a fait la France en 1789, la fonction de penser pour l’univers, de définir pour lui la justice, on ne devient pas propriétaire de chair humaine. [...]
[...]
Il est possible qu’aujourd’hui la France ait à choisir entre l’attachement à son Empire et le besoin d’avoir de nouveau une âme. Plus généralement, elle doit choisir entre une âme et la conception romaine, cornélienne de la grandeur.
Si elle choisit mal, si nous-mêmes la poussons à choisir mal, ce qui n’est que trop probable, elle n’aura ni l’un ni l’autre, mais seulement le plus affreux malheur, qu’elle subira avec étonnement sans que personne? puisse en discerner la cause. [...]
[...]
Mais si les sentiments du genre cornélien n’animent pas notre patriotisme, on peut demander quel mobile les remplacera.
Il y en a un, non moins énergique, absolument pur, et répondant complètement aux circonstances actuelles. C’est la compassion pour la patrie. [...]
[...]
Ce sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable, est autrement chaleureux que celui de la grandeur nationale. L’énergie dont il est chargé est parfaitement pure. Elle est très intense. Un homme n’est-il pas facilement capable d’héroïsme pour protéger ses enfants, ou ses vieux parents, auxquels ne s’attache pourtant aucun prestige de grandeur ? Un amour parfaitement pur de la patrie a une affinité avec les sentiments qu’inspirent à un homme ses jeunes enfants, ses vieux parents, une femme aimée. La pensée de la faiblesse peut enflammer l’amour comme celle de la force, mais c’est d’une flamme bien autrement pure. La compassion pour la fragilité est toujours liée à l’amour pour la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d’une existence éternelle et ne le sont pas.
[...]
Et cette compassion peut sans obstacles franchir les frontières, s’étendre à tous les pays malheureux, à tous les pays sans exception ; car toutes les populations humaines sont soumises aux misères de notre condition. Alors que l’orgueil de la grandeur nationale est par nature? exclusif, non transposable, la compassion est universelle par nature? ; elle est seulement plus virtuelle pour les choses lointaines et étrangères, plus réelle, plus charnelle, plus chargée de sang, de larmes et d’énergie efficace pour les choses proches.
[...]
Dans une période de stabilité sociale, où sauf exception ceux qui se trouvent dans l’anonymat y demeurent plus ou moins, où ils ne songent même pas à en sortir, le peuple ne peut pas se sentir chez lui dans un patriotisme fondé sur l’orgueil et l’éclat de la gloire. Il y est aussi étranger que dans les salons de Versailles, qui en sont une expression. [...]
Au contraire, si la patrie lui est présentée comme une chose belle et précieuse, mais d’une part imparfaite, d’autre part très fragile, exposée au malheur, qu’il faut chérir et préserver, il s’en sentira avec raison plus proche que les autres classes sociales. Car le peuple a le monopole d’une connaissance, la plus importante de toutes peut-être, celle de la réalité du malheur ; et par là même il sent bien plus vivement combien sont précieuses les choses qui méritent d’y être soustraites, combien chacun est obligé de les chérir, de les protéger. [...]
Si une telle relation s’établissait entre le peuple et la patrie, il ne ressentirait plus ses propres souffrances comme des crimes de la patrie envers lui, mais comme des maux soufferts par la patrie en lui. La différence est immense. [...] Cela suppose une dissociation entre la patrie et l’État. Cela est possible si la grandeur du genre cornélien est abolie. Mais cela impliquerait l’anarchie si, en compensation, l’État ne trouve pas moyen d’acquérir par lui-même un surcroît de considération. »
Simone Weil, L’enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain. Londres, 1943.